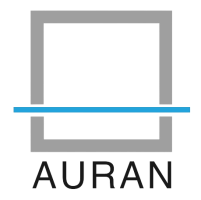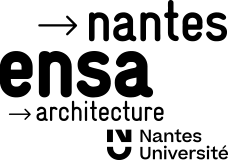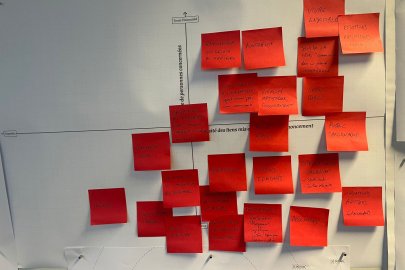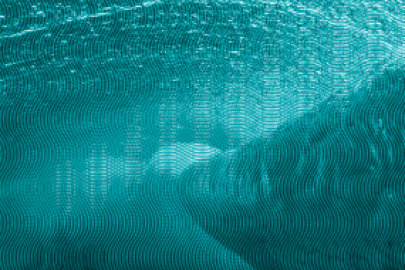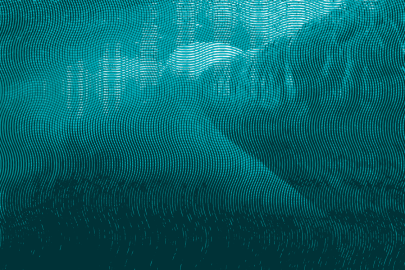À l’occasion de la première résidence de la Chaire Habiter au prisme des limites planétaires, près de 80 participant·es se sont réuni·es pour une journée de réflexions collectives autour de la redirection écologique. Tables rondes, ateliers et discussions informelles ont permis de croiser savoirs, expériences et pratiques pour imaginer ensemble des manières de faire bifurquer nos territoires à l’aune du nouveau régime climatique. Une dynamique stimulante, au service de nouveaux récits et de nouvelles manières d’habiter le monde.
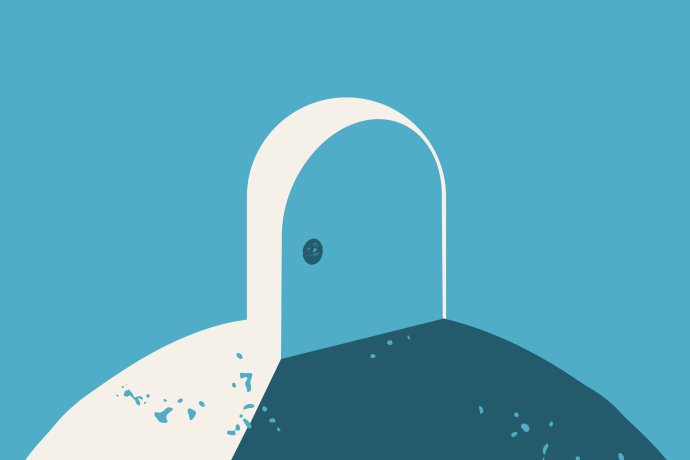

« Mettre les mains dans le cambouis », objectif assumé de ce premier festival de la chaire habiter : expression, au premier abord, peu attrayante mais qui explicite clairement l’enjeu et la méthode.
Mettre les mains dans le cambouis, c’est d’abord assumer que nous héritons d’une planète qui littéralement croule sous « l’insoutenable poids de la technosphère », issue de nos savoir-faire humains.
Mettre les mains dans le cambouis, c’est aussi se demander comment ensemble nous pouvons limiter l’impact de nos infrastructures, de nos organisations et les rediriger.
Mettre les mains dans le cambouis, c’est reconnaître en conscience et agir en toute responsabilité.
Et pour cela, nous avons invité à débattre en ce jour de clôture de la première résidence de la chaire habiter au prisme des limites planétaires occupée par Diego Landivar, quelques acteurs de la redirection écologique des territoires. Ensemble, nous avons clarifié les enjeux et réinventé des manières de penser et de faire pour comprendre nos activités tirées par la modernité et les faire bifurquer à l’aune du nouveau régime climatique.
Trois tables-rondes, 4 ateliers, et des temps de discussions informelles ont réuni près de 80 personnes pour une journée marquée par la joie, celle qui fédère celles et ceux qui cherchent et relèvent ensemble des défis.
Les table-rondes
La redirection écologique des métiers
Nous nous sommes appropriés les enquêtes réalisées pour rediriger certains métiers territoriaux présentées par Xavier Perrin, pilote du chantier Bifurcations à la ville de Grenoble ; nous avons approfondi avec Brigitte Nivet, professeure de management à l'ESC Clermont, comment parler du travail, ce qu'il nous fait et comment il nous transforme et mieux mesuré avec Agnès Agnès Renaudin - Le Meur, directrice des ressources humaines et de la RSE du groupe KERAN, comment, accompagner la redirection écologique à l'échelle d'un groupe de 800 salariés, se pense, s'organise, se planifie en acceptant le lâcher prise qu'implique de laisser l'initiative aux salariés dans la mise en œuvre.
Financer la redirection écologique
Pour imaginer ensemble comment réformer nos modèles économiques, nos systèmes de comptabilité et de financement pour accompagner les changements nécessaires, nous avions réuni Pierre de Boisdeffre, directeur stratégique de la Banque des Territoires Diego Landivar, titulaire de la chaire "habiter au prisme des limites planétaires", Gabriel Malek, président fondateur de Alter Kapitae, membre du CA de l'institut Rousseau et Denis Pourlier-Cucherat, Directeur Général du groupe KERAN. Rediriger, c’est renoncer à investir pour privilégier de maintenir, adapter, resserrer nos usages et redéfinir les fonctions sociales des politiques publiques. Quand l’innovation n’est pas le moteur, où peut-on trouver des financements pour ce faire ? Quel modèle devons-nous repenser ? Assumons-nous que ceux qui définissent nos systèmes de valeurs et de richesses doivent être renouvelés ?
Table-ronde « Après l’attractivité »
Cet échange riche, passionnant et nuancé s'appuyant sur des travaux de recherche et illustré par des exemples éloquents nous a permis d’explorer ce que le renoncement à l’attractivité implique, comment il est motivé et quels sont les territoires qui s’en réclament en particulier. avec Lionel Delbos, conseiller économie territoriale à France Urbaine Aziliz Gouez, vice-présidence à l'alliance des territoires et de l'enseignement supérieur et la recherche de Nantes Métropole Bastien Marchand, doctorant Lucie Renou, chargée d'études Agence d'urbanisme de la région nantaise Thibaud Tiercelet, DG SPLA Caen Presqu’ile.


Quatre ateliers
En fin de matinée, les participant·es se sont réparti·es en petits groupes pour expérimenter concrètement différentes approches de la redirection écologique à travers quatre ateliers immersifs et ludiques. Ces temps collectifs ont permis de croiser les expériences de vie, de partager les points de vue et de tisser des liens autour d’explorations pratiques et sensibles de la bifurcation.
Protocole de redirection écologique
Animé par Caroline Lanciaux, Clémence Aumond, Yann Thoreau La Salle et Lucie Renou, cet atelier proposait de partir d’un exemple concret d’infrastructure pour prendre conscience de nos dépendances matérielles. Les participant·es ont été invité·es à identifier leurs attachements, à réfléchir à ce qu’il serait possible de rediriger, et à imaginer collectivement les renoncements nécessaires, mais aussi les possibles à développer.
Atelier 28.07
Conduit par Yoan Brazy, cet atelier s’appuyait sur les outils développés par le collectif 28.07 pour imaginer, à travers des récits de territoire, des trajectoires de redirection situées. En se projetant dans des futurs désirables (et crédibles), les participant·es ont pu questionner leurs représentations et explorer d’autres façons d’habiter les lieux.
Atelier Zig Zan
Pensé comme un jeu coopératif et animé par Céline Zwickert et Philippe Bouteyre, l’atelier Zig Zan a proposé une mise en situation autour de la sobriété foncière. À travers cette simulation joyeuse et inclusive, les participant·es ont été amené·es à négocier, imaginer et planifier collectivement les usages d’un territoire fictif, en s’appuyant sur des principes écologiques et sociaux.
Atelier Micro-Donut
Imaginé et animé par Diego Landivar, cet atelier adaptait le modèle du Donut à l’échelle locale. En articulant limites planétaires et fondations sociales dans une approche territorialisée, les participant·es ont pu explorer de manière sensible les marges de manœuvre disponibles pour transformer leurs activités sans dépasser les seuils écologiques.