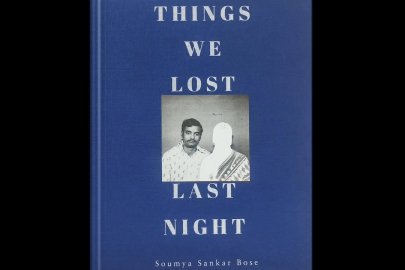Habiter avec équité ce petit monde duquel nous venons et dans lequel nous vivons
Sofiane Merabet
« Tu viens d’où ? » est la question qui m’est posée depuis que j’ai atteint l’âge d’être en mesure de répondre aux multiples interrogations auxquelles on n’a cessé de me soumettre tout au long de mon existence en tant qu’enfant d’une mère blanche et d’un père noir.

Dès l’âge de cinq ans quand j’ai été scolarisé, la question en elle-même m’a toujours un peu déboussolé. En l’occurrence, lui donner une réponse n’a jamais vraiment été facile pour moi. L’habituelle perplexité de mon expression faciale a souvent renforcé les doutes que certains interlocuteurs, enfants ou adultes, avaient à mon égard. Si je ne savais répondre à cette simple question, que révélerait cette incapacité sur mon identité ? Avais-je quelque chose à cacher ? Ce sont ces questions, posées ou pensées, qui me rendaient susceptible aux suspicions des autres.
À l’âge du primaire je n’avais pas encore maitrisé toutes les constructions discursives qu’il m’a fallu apprivoiser au fil des années pendant lesquelles je pivotais entre plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs systèmes éducatifs, et donc plusieurs manières d’appréhender la convoitise des origines. L’indélébile question « Tu viens d’où ? » en était le symbole incontesté. Bien plus tard, à l’âge de jeune adulte et après avoir parcouru les continents tout en laissant une grande partie de moi dans les terres d’Europe, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et des Amériques, je réalisais que ces terres subissaient des appellations qui étaient similaires aux obsessions classificatoires des identités individuelles et collectives que j’avais éprouvées depuis bien longtemps. Elles n’étaient que des conventions imposées par une histoire d’hégémonies coloniales continues. Cependant, une deuxième question s’ajoutait à la première.
« Tu vis où ? » est devenue assez vite l’épreuve par laquelle je devais passer. Suivant les endroits, le sens de la question changeait. Mais ce sens s’attachait toujours à des notions de société fondées sur des attributs de différence, et donc d’hiérarchie qui faisaient en sorte d’inclure certains et d’exclure d’autres. Pourtant, que signifie « vivre » au-delà de la relation que ce verbe entretient avec l’adverbe « où » qui, ensemble, nous interrogent imperturbablement sur le lieu de notre existence ? S’agit-il d’une évaluation d’où exactement on se situe dans un espace de ségrégation socio-raciale, de langue et de sexe, ou plutôt d’une supputation censée déterminer l’authenticité de l’accusé.e ? Ou est-il simplement question d’une sulfureuse combinaison des deux qui a pour qualité de s’arranger avec les pouvoirs du moment en vue de satisfaire les désirs de classifications des uns et la volonté de maintenir les différentes structures de domination des autres ?
Vivre dans un certain quartier, un village, une ville ou un pays nous marque aux yeux des autres, si non à nos propres yeux qui bien trop souvent restent dépendants des regards de ceux qui nous entourent. On est non seulement censé venir de quelque part de précis, on est aussi présumé de vivre dans un certain endroit et d’une certaine manière. Mais que signifierait pour nous alors d’« habiter un lieu autrement », de le revendiquer comme étant le nôtre, même si nous le partageons communément avec un grand nombre de nos voisins ? La réponse à cette question est compliquée sans doute car elle relève du « droit au lieu » qui fréquemment se heurte à l’opposition de ceux qui l’exige pour eux-mêmes tout en le refusant catégoriquement aux autres. Néanmoins ce n’est que collectivement que nous pouvons habiter avec équité ce petit monde duquel nous venons et dans lequel nous vivons. Ensemble il nous sera possible de l’aborder « autrement » et d’aller en avant quand il s’agit d’« habiter le monde avec différence », c’est-à-dire avec tout notre esprit critique bravant vigoureusement les bigoteries contenues qui aussi demeurent dans ce même monde.